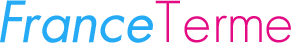La préoccupation du grand public pour la question du nucléaire fait régulièrement apparaître la nécessité de clarifier les termes du débat. C’est à cette tâche que se sont employés les experts du domaine, en nommant et en définissant essentiellement des concepts liés aux équipements ou aux mesures de sécurité mis en place pour se prémunir contre les risques inhérents à l’industrie nucléaire. Découvrez ce vocabulaire publié par la Commission d’enrichissement de la langue française au Journal officiel du 14 octobre 2025.
Tout d’abord, les experts ont souhaité éclaircir, pour les néophytes, la notion de « terme source » publiée en 1989 : si cette dénomination, calquée sur l’anglais source term, est ancrée dans le jargon professionnel, l’appellation rejet radioactif a paru plus transparente pour désigner la partie de l’inventaire des radionucléides d’une installation nucléaire qui est rejetée dans l’environnement en fonctionnement normal ou lors d’un incident ou d’un accident.
Les professionnels du nucléaire utilisent également l’expression « libération de déchets radioactifs » lorsqu’on retire la qualification de déchets radioactifs à des matériaux ne présentant pas de risque radiologique pour le public ou pour l’environnement. L’ambiguïté de cette désignation pouvant la rendre inquiétante pour le grand public, la Commission a préféré officialiser le terme déqualification de déchets radioactifs, plus explicite.
Les installations de stockage de déchets radioactifs*, justement, peuvent être protégées par différents types de barrières de confinement, telles que la barrière géologique (geological barrier) ou son pendant artificiel, la barrière ouvragée.
Autre structure en jeu dans le confinement des matières radioactives, l’enceinte de confinement d’un réacteur, qui peut être un bâtiment ou une cuve métallique. Dans cette enceinte de confinement se trouve une structure cylindrique appelée puits de cuve (reactor pit), qui contient la cuve du réacteur et protège les personnes et le matériel des rayonnements ionisants.
En cas d’accident grave, deux modes de gestion sont possibles :
– la rétention (du corium) en cuve (de réacteur) : le corium est maintenu et refroidi dans la cuve afin de prévenir le percement de celle-ci ;
– la rétention hors cuve : le corium qui a percé la cuve du réacteur est retenu dans une zone de l’enceinte de confinement (parfois un récupérateur de corium) où il peut être refroidi.
Enfin, mentionnons deux derniers concepts participant de la sûreté nucléaire :
– la cage de transport (bird cage) est une structure métallique d’un emballage de transport qui maintient suffisamment de distance entre les matières fissiles contenues dans des emballages juxtaposés ;
– la source froide (ultimate heat sink) désigne un milieu physique (mer, nappe phréatique, cours d’eau…) contenant un fluide utilisé pour refroidir une installation nucléaire.
Pour en savoir plus, cliquez sur les liens dans le texte et consultez ces termes complémentaires :
champ magnétique poloïdal (d'un tokamak), champ magnétique toroïdal (d'un tokamak), confinement amélioré, garant de conception, manche, rond de gant, rond de sac, solénoïde central, temps de confinement de l’énergie, transfert d’énergie entre faisceaux ou TEF.
Le groupe d'experts du nucléaire et d'autres membres du dispositif en visite au cœur du Centre de stockage des déchets de l'Aube (avril 2025).