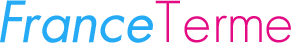Le sujet des batteries, notamment celles des véhicules électriques, est au cœur de la politique industrielle de l’Union européenne, avec des enjeux tant économiques qu’environnementaux. Leur fabrication repose sur une grande diversité de solutions techniques et, en France, des termes comme « batterie Li-ion » sont aujourd’hui connus même du grand public, sans que l’on sache précisément ce qu’ils recouvrent. Les experts des secteurs concernés (automobile, chimie, énergies, environnement, transports) se sont donc associés pour définir et nommer aussi clairement que possible ces concepts essentiels à l’heure de la transition énergétique. Découvrez les termes publiés par la Commission d’enrichissement de la langue française au Journal officiel du 12 décembre 2024.
Les batteries en quelques termes essentiels
Comme toute batterie, la batterie électrique est ainsi nommée parce qu’elle est composée d’un ensemble d’éléments destinés au même usage : dans le cas présent des accumulateurs électrochimiques, ou cellules, reliés entre eux. Ces accumulateurs sont des cellules électrochimiques rechargeables qui stockent de l’énergie électrique, et peuvent être regroupés en modules de batterie. Les plus courants sont les cellules cylindriques, mais on utilise aussi des cellules poches, des cellules prismatiques, ou encore des cellules lames.
La Commission nous aide à mieux distinguer la capacité nominale d’une batterie (rated battery capacity) de la capacité utile (effective capacity). La première correspond à la quantité d’électricité qui peut être restituée par une batterie totalement chargée dans les conditions spécifiées par le constructeur, la seconde varie en fonction de ses conditions d’utilisation (par exemple, la température extérieure).
L’objectif est aujourd’hui de fabriquer des batteries qui présentent notamment une faible empreinte écologique tout au long de leur cycle de vie : la Commission les nomme batteries durables (green / sustainable batteries), cet adjectif étant désormais communément associé, dans l’usage, au domaine de l’environnement. Leur recyclage passe par un traitement précautionneux du broyat noir (black mass), du fait de la toxicité des particules qu’il contient.
Quelques considérations techniques
La Commission entérine le terme batterie lithium-ion (qui s’écrit aussi batterie Li-ion), largement entré dans l’usage aussi bien chez les professionnels que dans les médias, tandis que le synonyme batterie à insertion de lithium vient refléter plus explicitement la technologie à l’œuvre.
La batterie nickel-manganèse-cobalt (NMC) et la batterie phosphate de fer et de lithium (ou batterie LFP) sont deux types de batterie lithium-ion, qui diffèrent par le matériau d’insertion, un composant essentiel des électrodes de ces batteries.
On découvre aussi la batterie tout-solide, ou batterie à électrolyte solide (BES), ou encore la batterie métal-air, dont les accumulateurs possèdent chacun une électrode négative métallique – par exemple en zinc dans la batterie zinc-air – et une électrode positive en carbone poreux en contact avec l’air.
Des batteries qui roulent pour l’automobile
Les innovations en matière de batteries intéressant au premier chef l’industrie automobile, évoquons-en trois concepts spécifiques :
– la batterie de traction est capable de fournir l’énergie nécessaire au déplacement d’un véhicule électrique ou hybride ;
– elle fait partie du bloc de batterie (battery pack), tout comme le système de gestion, qui assure le contrôle et l’optimisation du fonctionnement de la batterie.
Consultez les fiches dans leur intégralité pour en savoir plus sur les types de batterie, leurs différentes appellations, leurs caractéristiques, avantages et inconvénients ! Et découvrez ces termes complémentaires :
batterie stationnaire, batterie lithium-soufre (Li-S), batterie sodium-ion (Na-ion), batterie à lithium métallique et électrolyte polymère (LMP), matériau d’intercalation, oxyde lamellaire.