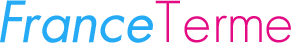1. Silvia Zollo, qui êtes-vous ?
Je suis professeure associée en linguistique française et traduction à l’Université de Naples Parthénope où j’enseigne le FOS (Français sur Objectifs Spécifiques) et les langues de spécialité. Titulaire d’un Doctorat Européen en Linguistique française obtenu en 2017, mes recherches portent sur la néologie du français contemporain, la terminologie et l’analyse des phénomènes langagiers opérant au niveau lexico-discursif, ce qui implique des études dans plusieurs disciplines connexes, comme la lexicologie, la sémantique lexicale, la terminographie, la phraséologie, la linguistique de corpus, l’analyse du discours et la traduction spécialisée.
Je fais partie du Comité scientifique de lecture de la revue internationale Neologica (Classiques Garnier) et depuis 2022 je suis responsable du projet Littératie océanique : observations linguistiques, données terminologiques et modélisations lexicographiques basées sur corpus (français-italien), qui m’a permis de combiner mes deux plus grandes passions : la linguistique et les sciences de la mer.
2. Vous collaborez avec le DELF (dispositif d’enrichissement de la langue française) pour l’élaboration d’un vocabulaire des océans. Quels bénéfices et perspectives peuvent être envisagés ?
La coopération avec le DELF s’est avérée très fructueuse et enrichissante. Nous avons travaillé dans le cadre d’une approche collaborative et intégrée qui a permis d’aborder un nombre croissant de termes autour des océans : nous nous sommes efforcés de couvrir la variété des domaines, d’identifier les cas les plus problématiques et de développer des protocoles pour traiter chaque cas de manière appropriée. J’ai également constaté un intérêt commun pour l’amélioration des méthodes et une volonté partagée de collaborer autour de procédures expérimentales qui engagent les experts : leur contribution a été cruciale pour la gestion des termes et la systématisation de certaines définitions, en particulier lors du transfert des connaissances entre les différentes langues et cultures.
Enfin, je souhaiterais souligner l’importance des corpus qui, notamment pour les termes émergents, ont constitué la seule source d’information disponible pour extraire le lexique. Les corpus offrent un réservoir bien structuré de contextes définitoires authentiques dans lesquels apparaissent variantes terminologiques, néologiques et conceptuelles, susceptibles de se prêter dans le futur à des réflexions méthodologiques sur le traitement terminographique de la définition.
3. Utilisez-vous FranceTerme dans le cadre de vos activités professionnelles ?
FranceTerme est l’un des principaux instruments sur lesquels je m’appuie pour mener mes recherches, tant pour la veille néologique que pour l’étude des termes nouveaux. Par ailleurs, je recommande FranceTerme à tous mes étudiants : son interface est simple et très conviviale. Il intègre un très large éventail de domaines et de termes scientifiques et techniques, ce qui le rend sans aucun doute une ressource essentielle pour la société et indispensable pour de nombreux professionnels. En termes de besoins sociétaux, cette base a le grand mérite d’être à la fois participative, grâce à la « Boîte à idées », et ouverte, en offrant les fiches en plusieurs formats ouverts et standards (comme le RDF ou le XML), qui peuvent être réutilisées par les apprenants sous forme d’ontologies, de réseaux lexicaux ou d’applications pour l’enseignement-apprentissage des lexiques de spécialité. À ma connaissance, ce sont deux caractéristiques absentes des autres ressources terminographiques de ce type.