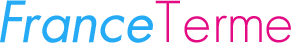Black bloc, roll back, chicken game… Le vocabulaire des relations internationales, précisément du fait de sa thématique, est particulièrement perméable aux anglicismes. Pourtant, qu’ils soient politiques ou environnementaux, ces sujets peuvent être traités en français ! Découvrez la liste des termes élaborés par les spécialistes de ces domaines et publiés par la Commission d’enrichissement de la langue française au Journal officiel du 15 septembre 2020.
Si l’on vous parle des cagoules noires, vous visualiserez aisément ces groupes généralement désignés par l’appellation anglaise black bloc, largement entendue en France à l’occasion des différentes manifestations de l’hiver dernier. Le choix de cet équivalent français permet aussi d’individualiser les membres de ces groupes en parlant d’un cagoule noire, au singulier.
Mais les tensions ne s’expriment pas toujours par la violence : pour désigner la stratégie de surenchère que déploient par exemple deux États afin de faire céder l’adversaire, l’anglais parle de chicken game. Plutôt que de conforter la traduction quasi littérale de « jeu de la poule mouillée », parfois utilisée mais peu explicite, la Commission a préféré opter pour le terme bras de fer, implanté depuis longtemps dans le vocabulaire des relations diplomatiques.
Formé à partir de démocratie et dictature, le mot-valise démocrature (illiberal democracy) est, du fait de sa construction, assez transparent. Cette combinaison de deux notions antagonistes évoque presque en elle-même l’idée d’un simulacre ou d’une tromperie : le suffixe –(a)ture vient révéler dans un second temps que l’amorce du terme évoquant la démocratie n’était qu’illusion…
Autre néologisme, l’urbicide vient s’ajouter à la lugubre liste des mots évoquant le fait de tuer ou détruire, les cibles étant ici des villes, en contexte de conflit armé.
Si l’urbicide contraint à la fuite les habitants survivants, les phénomènes environnementaux sont eux aussi un facteur entraînant des mouvements de population, à l’échelle nationale ou internationale. Pour qualifier les personnes amenées à quitter leur région pour ces motifs, les experts nous invitent à distinguer deux termes qui désignent des notions ne se recouvrant que partiellement : le ou la migrant, -e climatique (climate migrant) est en effet un cas particulierdu / de la migrant, -e environnemental, -e (environmental migrant), dont le départ peut être lié à un éventail plus large de situations (pollution, séisme…).
Bien que les nouveaux termes soient la plupart du temps proposés pour remplacer des anglicismes, il arrive que des termes étrangers non anglophones se répandent aussi dans l’usage. C’est le cas de l’efecto cucaracha, vocable espagnol souvent utilisé en référence à des questions de criminalité, notamment la lutte contre le trafic de drogue. Mais ce que l’anglais nomme de son côté balloon effect s’applique aussi à d’autres domaines (économie, santé…). Pour recouvrir l’ensemble de ces usages, les experts proposent l’équivalent français résurgence.
Enfin, les questions géopolitiques sont aujourd’hui indissociables de la mondialisation numérique. Parce qu’elle marque une rupture avec celles qui l’ont précédée, la génération des enfants du numérique ayant atteint l’âge adulte au début du nouveau millénaire méritait une désignation particulière. Exceptionnellement, la Commission a entériné un terme à consonance anglo-saxonne car son usage était déjà très implanté : on parle donc d’un-e millénial, -e (en anglais millennial) et de la génération milléniale.
Même si vous n'appartenez pas à la génération milléniale, vous parviendrez sans nul doute à retrouver sur le site FranceTerme les autres termes publiés au Journal officiel du15 septembre 2020 : endiguement, migration de retour et refoulement !